Dire la mort : ce que révèle l’expression «corps sans vie»
La formule « corps sans vie » est désormais omniprésente dans les médias.
À chaque fait divers, à chaque disparition tragique, le même détour lexical revient, implacable, avec une régularité presque mécanique : « le corps sans vie de… ». Elle s’est imposée comme un standard journalistique, une évidence stylistique, au point qu’on n’y prête plus attention.
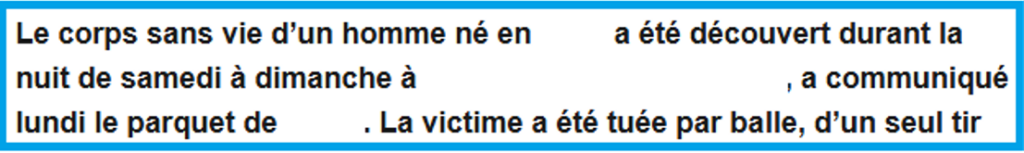
Pourtant, j’estime que cette expression mérite qu’on s’y arrête.
Non pas pour un simple débat de vocabulaire, mais parce qu’elle révèle quelque chose de plus profond sur notre rapport à la langue — et à la mort.
Pourquoi avoir presque entièrement évacué du discours médiatique le mot précis pour désigner une personne décédée : cadavre ?
Un mot ancien, clair, juridiquement et médicalement exact, un mot qui ne décrit pas, mais qui nomme, au profit de cette périphrase molle qu’est « corps sans vie » ?
Qui plus est, cette expression est une tautologie. Quand une personne est décédée, le corps ne peut être que sans vie. Inutile donc d’ajouter « sans vie » à corps. Si le journalisme rechigne à dire « cadavre », écrire « un corps a été retrouvé… » suffirait — précis, neutre, sans redondance.
C’est cette douceur feinte qui pose question.
J’y aperçois probablement une volonté d’adoucir la dureté de la mort. Le mot cadavre serait-il perçu comme trop brutal, frontal, dérangeant ? Ce mot impose pourtant la réalité de la mort, sans filtre ni détour. À l’inverse, « corps sans vie » procède par négation, ce n’est pas un mort, c’est un corps auquel il manque quelque chose. La mort devient une absence plutôt qu’un état. On la suggère au lieu de la dire.
Mais cette précaution est-elle réellement une marque de respect ? Ou n’est-elle qu’un moyen de se protéger, en tant que société, du malaise que suscite la mort ? Car le respect ne réside pas dans l’évitement des mots justes, il réside dans la précision, dans la justesse du langage face au réel.
Il est paradoxal de constater que cette tautologie « corps sans vie » s’évanouit dès qu’il s’agit de soldats tombés au combat ; on lit alors « trois cadavres de soldats ont été retrouvés » ou « le corps du soldat tué a été rapatrié », comme si la mort d’un militaire, parce qu’elle fait suite à un fait de guerre, méritait moins d’euphémisme, — une distinction dérangeante, car une vie humaine en vaut une autre, fût-il soldat.
Il en va de même pour les animaux, jamais nous ne lisons « le corps sans vie d’un chevreuil », mais toujours « le cadavre d’un chevreuil ». La vie animale, dans l’inconscient collectif, vaut moins que la vie humaine, à tort ou à raison, l’homme ne peut pas s’identifier à l’animal.
Ce glissement lexical participe d’une tendance plus large, celle d’une langue publique de plus en plus aseptisée, normalisée, presque technocratique. Une langue qui cherche à ne froisser personne, à ne choquer en aucun cas, quitte à perdre en netteté. Là où un mot suffit, on préfère une périphrase. Là où un concept est clair, on le dilue dans une formulation neutre, impersonnelle, interchangeable.
La langue ne sort jamais indemne de ces contournements répétés.
À force de remplacer les mots précis par des formules vagues, on affaiblit la pensée elle-même. Nommer, c’est comprendre. Nommer, c’est affronter. Décrire sans nommer, c’est rester à distance.
Dire cadavre, ce n’est pas être insensible. C’est reconnaître l’irréversibilité de la mort. C’est accepter que certaines réalités ne puissent être adoucies sans être déformées. La mort n’est pas violente parce qu’on la nomme et ce n’est pas en la recouvrant d’un vernis lexical que l’on en atténue la portée humaine.
Cette peur des mots révèle peut-être une peur plus profonde, celle de regarder la mort en face. Dans une société qui valorise la performance et le mouvement, la mort est devenue un impensé, un impoli du discours public. Alors on la contourne, on la désigne par défaut, on la rend abstraite.
Mais une langue vivante n’est pas une langue confortable. C’est une langue capable de dire le réel, même lorsqu’il dérange. En refusant de nommer la mort, on n’en protège ni les vivants ni la mémoire des morts. On se contente de s’anesthésier collectivement.
Peut-être est-il temps de réhabiliter les mots exacts.
Non par provocation, mais par fidélité à ce que la langue française sait faire de mieux : dire les choses clairement. La mort mérite mieux que des détours ; elle mérite d’être nommée. Il n’y a rien de dérangeant à écrire « le cadavre d’une personne a été retrouvé… ».
Ainsi, face à la mort, choisissons la langue qui nomme sans trembler. Réhabiliter « cadavre » n’est pas un scandale, c’est un acte de vérité. Car une société qui refuse de dire la mort finit par la nier. Oser nommer, c’est honorer les disparus et réveiller les vivants, la mort mérite ce courage lexical, écrivons-le sans filtre ni tabou : « cadavre »
Alain Schenkels
Décembre 2025

(Photo entête : Scène de crime RgStudio)














